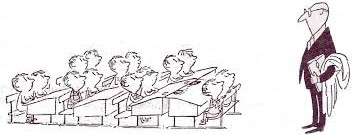Le premier ministre français Manuel Valls et la ministre de l’Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem, sous l’impulsion du comédien Jamel Debbouze, ont proposé il y a quelques mois d’introduire l’improvisation théâtrale dans le cursus de certains écoliers. Plus précisément, ils se sont dit prêts à renforcer l’apprentissage de la langue française et la pratique artistique collective dans certaines zones d’éducation prioritaires. Malgré les levées de boucliers d’une partie de l’opinion publique de l’Hexagone, il nous est permis de nous questionner sur la pertinence et l’efficacité d’une telle démarche ainsi que sur la possibilité d’importer un tel projet au sein des écoles vaudoises, sans pour autant bouleverser la grille horaire ou diminuer les heures des disciplines dites traditionnelles.
L’art de l’improvisation, de la création théâtrale spontanée, trouve son origine dans plusieurs valeurs émancipatrices, parmi lesquelles nous pouvons relever l’écoute ou le lâcher-prise. Improviser, c’est avant tout communiquer avec l’autre, créer ensemble, dans un esprit de déférence réciproque, à l’aide du corps, de la voix ou du regard.
Proposer l’improvisation théâtrale aux élèves en situation précaire ou scolairement fragiles pourrait constituer une solution pertinente, dans l’optique de les remettre sur les bons rails. À regarder de près l’article 104 de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), on constate que « l’enseignant fixe des objectifs personnalisés pour l’élève qui n’est pas en mesure d’atteindre ceux du plan d’études ». Ne tombons pas dans le piège de vouloir à tout prix imposer des appuis aux élèves en dérive scolaire, tels que décrits dans l’article susmentionné, alors que c’est précisément l’excès d’études qui provoque chez eux une aversion pour l’école. Prescrivons-leur plutôt des activités artistiques enclines à renforcer, par exemple, la pratique orale de la langue, puisque l’écrit est anxiogène pour ce type d’écoliers. C’est souvent parce que les productions écrites de ces apprenants sont défaillantes qu’il leur a été proposé un programme personnalisé ou un enseignement de type spécialisé.
L’improvisation théâtrale aurait le mérite de renforcer l’estime que certains élèves ont d’eux-mêmes et d’améliorer leur capacité à structurer mentalement leur pensée, de façon à pouvoir, dans un deuxième temps, s’atteler à l’expression écrite, objectif somme toute final de la scolarité.
Sans prétendre que cette piste constitue la panacée, elle permettrait aux professionnels de l’enseignement d’avoir des outils à disposition afin d’offrir aux élèves précités de quoi renforcer leurs aptitudes scolaires et leur intégration dans la vie active.